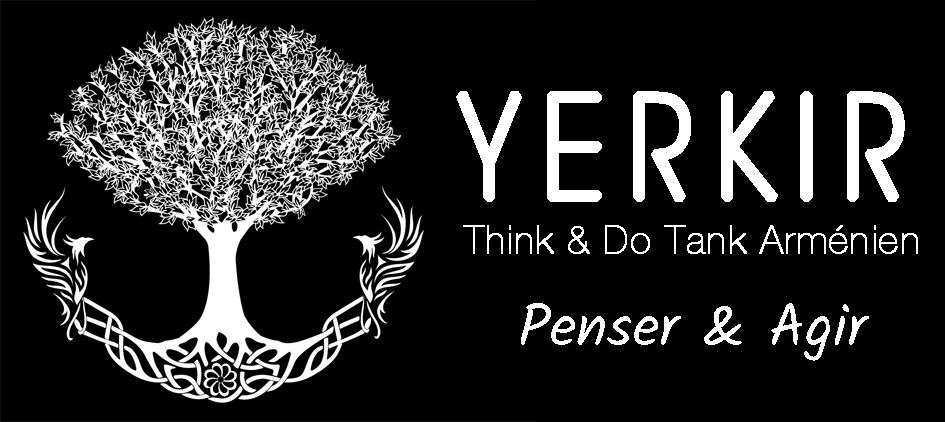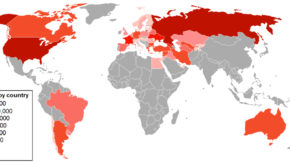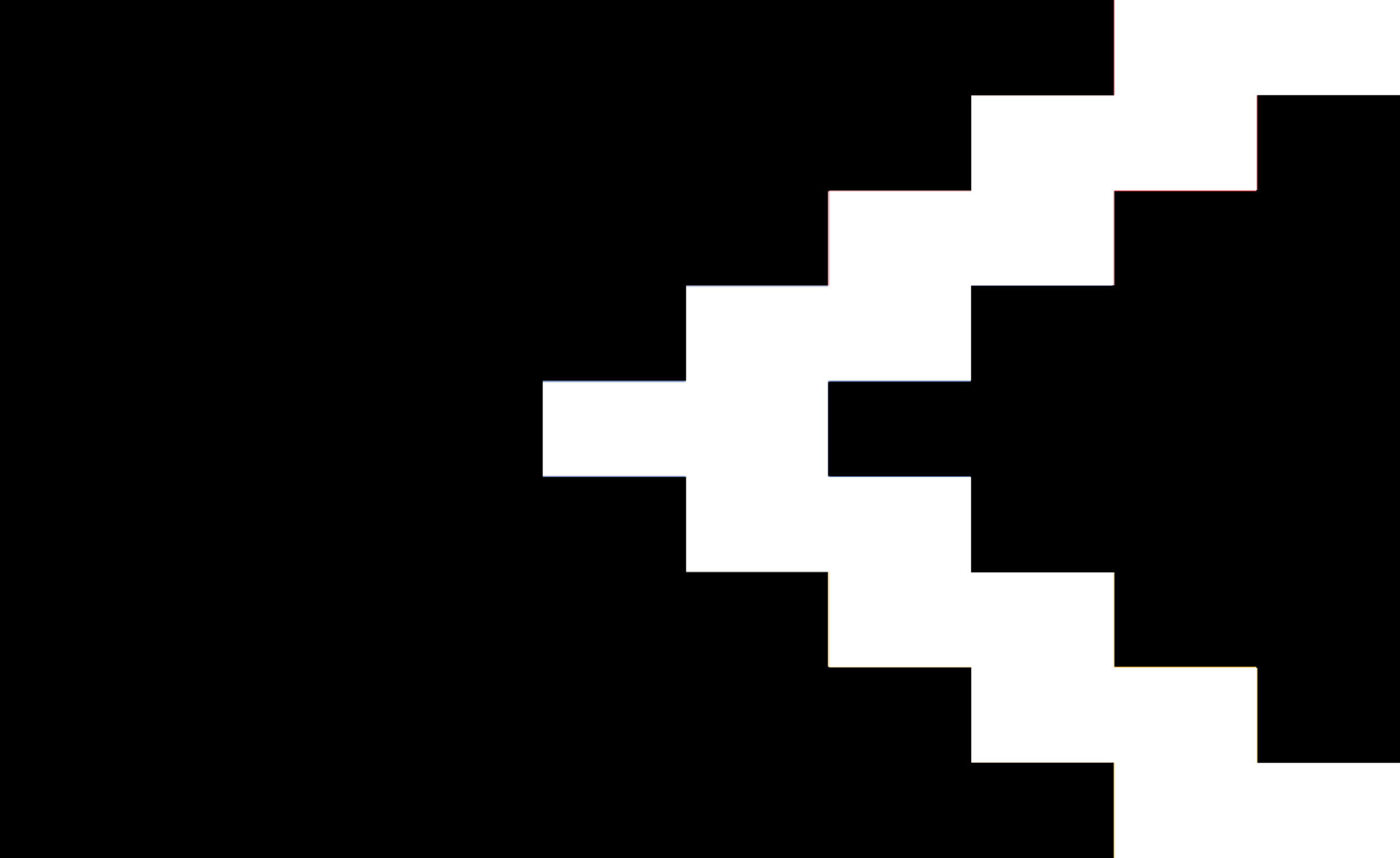Chargement

Reconnaissance du Génocide et réparations territoriales sont deux combats différents
24 septembre 2015
le rapport Résolution avec Justice : Réparations pour le Génocide Arménien a vu le jour à la veille du centenaire du génocide des Arméniens. Il a été rédigé par le Groupe d’études des réparations du génocide des Arméniens composé de Henry Theriault, Alfred de Zayas, Jermaine O. McCalpin et Ara Papian.
chat_bubble0 Commentaire
visibility3911 Vues

Réparations du Génocide Arménien, entre rêveries et réalités
7 septembre 2015
Cet article expose de manière critique les thèses publiques qui ont actuellement cours et les actions en justice pendantes en ce qui concerne les réparations individuelles ou collectives réclamées par des institutions ou des particuliers arméniens de diaspora.
chat_bubble0 Commentaire
visibility4355 Vues

Un nouveau centenaire, entre problèmes du passé et futur incertain
24 juin 2015
Dans cet article, Hakob Badalyan revient notamment sur la question des réparations, devenue d’une grande actualité, et cite les déclarations d’Aram 1er et de Garèguine II sur ce thème.
chat_bubble0 Commentaire
visibility3590 Vues