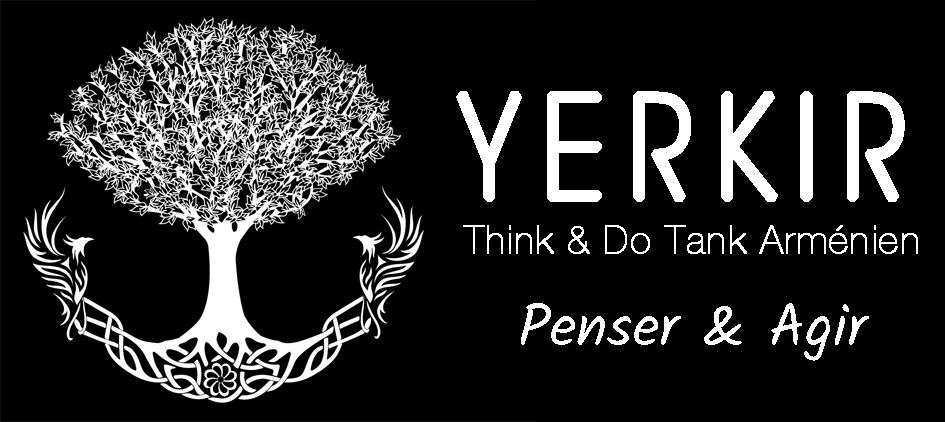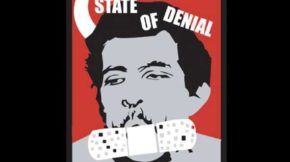Lilit Gasparyan
Turcologue et journaliste d’Arménie
Lilit Gasparian, journaliste et turcologue d’Arménie, au travers de son expérience personnelle et professionnelle nous explique sa vision de l’identité arménienne et turque. Lilit Gasparyan, après des études de turcologie à Paris, devient la correspondante à Istanbul de la chaine de télévision d’Arménie Yerkir Media. Elle est aujourd’hui la correspondante du journal Agos à Erevan.
L’identité réunit en elle les traits du passé et du présent par lesquels s’ébauche son visage de demain. Fait semble-t-il exceptionnel, l’identité arménienne s’est façonnée d’une façon singulière dans les divers coins du monde. La plus tragique est celle des Arméniens islamisés ou Arméniens cachés de Turquie, dont le maintien de l’identité est pour chacun d’eux un combat de tous les jours.
Sur fond de plaies historiques, la Turquie est cet Etat terrifiant que nous associons généralement, ou plutôt presque toujours, à l’ennemi. Telle est notre représentation de ce pays tant que l’on ne l’a pas visité au moins une fois. Mais quel que soit l’âge auquel on s’y rend pour la première fois, même jeune ou adolescent, c’est un déluge d’impressions. Et le fait que j’étais encore enfant lorsque j’ai visité la Turquie pour la première fois n’est pas essentiel, car je n’avais qu’une idée en tête : celle que je me rendais en pays ennemi. Qui pouvait imaginer que, conséquence de cette visite, je me retrouverais des années plus tard à Paris, et que j’y étudierais ce pays dans les moindres détails ? Le choix de Paris non plus n’était pas dû au hasard… L’écoute de ce qui se rapportait à la Turquie exigeait de se trouver dans un pays tiers, en zone neutre.
C’est ainsi que j’ai étudié ce pays pendant trois ans, en mettant de côté ma fibre nationale et les plaies transmises par l’Histoire. Mais au delà d’un certain point, l’étudier à distance ne suffisait déjà plus. Un beau jour, grâce au programme Erasmus qui organise des échanges d’étudiants, je me suis retrouvée en Turquie. Face à une réalité qui m’était si étrangère j’étais assaillie de sentiments contradictoires. Mes camarades d’université s’amusaient visiblement à m’étourdir de questions, moi l’Arménienne venue de Paris, et ce, dans un français presqu’aussi fluide que le mien. Les relations avec les étudiants et le corps professoral étaient d’une cordialité proprement fantastique, si l’on excepte l’incident qui eut lieu lors de mon exposé consacré à l’épopée arménienne, lorsque j’ai présenté le Sassoun comme une région « qui se trouve en Arménie occidentale », ce qui a indigné un grand nombre des personnes présentes.
La première fois que j’ai réfléchi à la notion d’identité, ce fut à la suite de l’évènement suivant : durant mes années d’études et jusqu’à ce que je me rende à Istanbul, je traquais chez mes professeurs, qu’ils soient d’origine turque résidant en France, français, le moindre de leurs propos relatifs à la Turquie et notamment à ses minorités. Tout était nouveau pour moi, et n’avait rien à voir avec les faits tragiques que l’on trouvait en Arménie dans les livres d’histoire. Le tableau s’est encore modifié lorsque je me suis retrouvée en Turquie. Là, tout était si différent, depuis la conception du nationalisme jusqu’à celle de l’identité. En dehors des Turcs eux-mêmes et de ce qui relevait du fait turc, tout m’était extrêmement étranger.
En Arménie, le paradoxe est ailleurs. Et cela apparaît beaucoup plus clairement lorsque l’on revient en Arménie après avoir habité quelques années à Istanbul. Globalement on y considère comme arménien celui qui y vit, tandis que ceux qui habitent à l’extérieur sont des « Arméniens de la diaspora » (« Spurkahay »). Mais les uns comme les autres partagent le même stéréotype, à savoir qu’est arménien celui qui est chrétien et parle arménien. Et cela sans tenir compte du fait que durant les années soviétiques, la majeure partie de la population du pays n’était pas baptisée et ne faisait donc pas partie de l’Eglise apostolique arménienne, sans oublier ceux qui sont restés non baptisés à ce jour.
Lorsque la véritable identité tourne au pur cauchemar ou conduit à d’interminables questionnements, ce qui est le cas pour un nombre considérable d’Arméniens (de Turquie), on peut deviner à quoi ressemble alors leur vie. Il n’est pas exagéré de dire que la Turquie traverse aujourd’hui une sérieuse crise d’identité, et que c’est dans les territoires de l’Arménie historique qu’on en voit les manifestations les plus précises. Il est notable que la chape de plomb entourant cette question durant ces dernières années en Turquie y ait stimulé la quête identitaire. Au point que de chercher à reconnaître un Arménien dans le moindre passant de la rue est devenu une habitude. Traverser ces territoires que nous autres, Arméniens, appelons Arménie occidentale, mais que les Turcs appellent Anatolie et les Kurdes Kurdistan, impose à chaque Arménien de faire preuve d’une grande force morale. Je n’étais pas une exception.
Le plus important, probablement, est de trouver le point d’appui sur lequel bâtir les relations entre Arméniens et Turcs. Les dernières années ont vu se succéder les sommets et les rencontres d’organisations non gouvernementales toujours plus inédits les uns que les autres, auxquels participent des journalistes turcs et arméniens. C’est à force d’avoir participé à ce genre de réunions que je me suis rendue compte de l’importance de ce qu’on appelle le dialogue. Mais peu après, la déception fut inévitable.
J’ai eu l’occasion de participer au voyage que des journalistes arméniens et turcs ont effectué en bus, de Malatya à Erevan. Alors que nous étions débout à côté des ruines du monastère de Saint Grégoire l’Illuminateur, j’ai demandé à mon camarade turc ce qui l’avait le plus ému. Sa réponse fut courte et rapide : « Rien ». Je fus saisie l’espace d’un instant, et je me suis demandée : si le fait qu’il ne soit plus « rien » resté de cet immense complexe monastique arménien ne provoque « rien » chez lui, aucune réaction, alors de quel dialogue parle-t-on, ou plutôt qu’attendre d’un tel dialogue ?
Le voyage commencé à Malatya suggérait qu’il fallait s’attendre à tout. Nous avons fait la connaissance d’un Arménien du nom de Sèrdar qui ne savait pas parler arménien. Une question tourmentait mes collègues arméniens : pourquoi ne sait-il pas parler arménien ? Sèrdar avait du mal à expliquer tout cela. C’est un fait, il ne le parlait pas, mais il se sentait bien plus arménien que bien des Arméniens.
Du temps de mes études universitaires, nos professeurs turcs répétaient souvent que ces dernières années, la Turquie faisait beaucoup de progrès au plan démocratique. C’est en partie exact, mais la démocratie et la liberté de parole y ressemblent parfois plutôt à des étoiles lumineuses : on les voit briller, on s’extasie, mais elles restent hors de portée, impalpables. Alors que, à contrario, des milliers d’Arméniens tels que Sèrdar essayent de vivre réellement selon leur vraie identité, avec prudence, la peur au ventre, au point de transformer leur vie en un trouble et une lutte moralement épuisants.
La conversation avec Sèrdar s’est poursuivie dans un endroit triste, à savoir le cimetière arménien. Celui-ci a été rénové exclusivement grâce aux efforts des Arméniens, ce qui en a fait la cible des médias turcs locaux pendant très longtemps. Le petit lieu de prière qui avait été édifié dans le cimetière ayant été assimilé à une église, les autorités locales l’ont fait démolir sans état d’âme. Ainsi est la Turquie : portée aux nues pour sa tolérance, mais n’ayant pas pu tolérer qu’on prononce une dernière prière (chrétienne) pour les défunts. Au cimetière, j’ai toujours en vue l’expression islamique turque : « R’ouhouna Fat’iha » Pourquoi ? Pour protéger les pierres tombales contre d’éventuels assauts.
La nécessité de cacher son identité chrétienne ou arménienne pour se protéger laisse sans réponse la question suivante : pourquoi les gens sont-ils obligés de changer de religion pour rester en vie (en écrivant ces lignes, j’ai appris il y a quelques heures par la presse qu’en Syrie, on a décapité un jeune Arménien du nom de Massis, pour avoir refusé d’embrasser l’Islam), ou encore : pourquoi les églises dont la plupart sont tombées au sol, ne sont-elles rénovées par l’Etat qu’à condition d’être transformées en bibliothèque ou en centre culturel ? Ce sont des questions dont nous avons les réponses, sans pouvoir rien y changer.
Au cours de l’expédition, je traitais mes compagnons de route de « collègues turcs ». C’est sous ce vocable que je parlais d’eux, jusqu’au moment où l’un d’entre eux a dit : « Je n’aime pas cette expression. Moi, je ne suis pas turc : je suis de Turquie ». Voilà de quoi méditer et ranger ses idées à la remise ! A un moment, la fameuse expression — « Heureux celui qui se dit turc » —, m’a traversé l’esprit. Pourquoi mes collègues ne sont-ils pas heureux ? Mieux, pourquoi se défendent-ils tant d’être appelés « turcs » ? Encore un questionnement qui induit une réponse complexe.
Finalement, l’identité de chaque peuple est conditionnée par son cheminement historique, par le système de valeurs et la civilisation qu’il a créés, ainsi que par les rêves globaux d’avenir qui sont les siens. Néanmoins l’identité n’est pas une notion figée et conceptualisée une fois pour toutes. L’identité — ainsi d’ailleurs que la culture qui la détermine — évolue et change au cours du temps. Ce qui ne change pas en revanche, c’est la force du sentiment d’être « Arménien », qui ne se limite ni à l’appartenance religieuse, ni à la pratique de la langue, ni même à la connaissance de la culture.